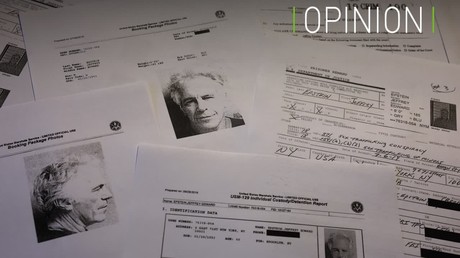Le président américain Barack Obama a donné une interview, publiée dans le journal américain The Atlantic. Mais serait-ce sa voix que l'on entend ou plutôt celle du journaliste qui l'a interviewé ? John Laughland cherche la réponse.
Le long article publié par Jeffrey Goldberg dans The Atlantic sur la politique étrangère du président Obama, dont le mandat approche du terme et autour duquel les vautours sont donc en train de voler en rond, est remarquable moins pour son contenu que pour la perspective qu'il nous offre, malgré lui, de ce que seront les Etats-Unis dans l'ère après Obama.
Plus militant politique que journaliste, Jeffrey Goldberg est un néo-conservateur notoire. Il en est d'ailleurs presqu'une caricature – son soutien inconditionnel à Israël, son reflexe de voir dans la guerre la solution à tous les problèmes de la planète, son obsession de l'islam et de l'anti-sémitisme. Washington fourmille de gens comme lui, qui ne parlent que de politique étrangère, du rang des Etats-Unis dans le monde et qui tirent ainsi toujours la couverture à eux, en dépit de toute discussion sur la politique intérieure des gouvernements américains successifs.
Selon une malencontreuse habitude anglo-américaine, et contrairement aux habitudes françaises et allemandes, les «entretiens» avec des personnalités ne sont pas publiés en forme de questions et réponses mais en forme d'articles où le journaliste s'interpose entre la personne interviewée et le lecteur. Dans le cas de ce texte long et difficile, on a l'impression d'écouter Jeffrey Goldberg bien plus qu'Obama. Cela est dejà fort ennuyeux ; pire encore est la façon dont la vision déformée de Goldberg fausse la réalité dont il parle.
On peut donc se réjouir de certains de propos du président Obama, et notamment de son affirmation selon laquelle on ne pourra jamais résoudre tous les problèmes de la planète
Jeffrey Goldberg lance son réquisitoire contre Obama – car il s'agit bien de le dépeindre comme un lâche qui a saboté le rang des Etats-Unis dans le monde au profit d'un réalisme affiché qui cacherait un isolationnisme qui n'ose pas dire son nom – en lui imputant la responsabilité de la non-intervention en Syrie en septembre 2013. Barack Obama aurait ainsi trahi ses propres engagements et notamment celui de ne pas laisser Damas franchir une «ligne rouge» en utilisant des armes chimiques.
Mais la façon dont Jeffrey Goldberg raconte l'histoire traduit sa propre vision tunellaire et manichéenne, où tout est présenté en termes de choix pour le bien, devant lequel le président américain aurait reculé. Mais le pauvre locataire de la Maison Blanche n'y était pour rien: les événements lui ont tout simplement échappé. Le vote contre la guerre de la Chambre des Communes [chambre basse du Parlement britannique] du 30 août 2013 a déjoué la guerre programmée. D'abord parce que les Américains ont perdu leur allié le plus sûr et ensuite parce que le Congrès américain revendiquait, lui aussi, de se prononcer sur la question, les républicains n'ayant aucune intention de intention de soutenir le président Obama. La finesse de la diplomatie russe et l'opération du Saint-Esprit fera le reste : en effet, le Pape avait annoncé une journée mondiale de prière et de jeune pour la paix en Syrie le 7 septembre. Trois jours plus tard l'accord sur le désarmement chimique de la Syrie était conclu.
Par conséquent, entre le journaliste militant et le président sortant qu'il méprise, une certaine complicité émerge : Barack Obama doit présenter son échec patent non pas comme le résultat de facteurs extérieurs qu'il ne pouvait pas contrôler mais, au contraire, comme le fruit de sa propre vision longtemps mûrie de la politique étrangère. Le journaliste-agitateur, quant à lui, joue le jeu afin de marteler le message que lui et son équipe feront tout pour que la parenthèse du réalisme affirmé de l'administration Obama sera vite refermée au profit d'un retour à un interventionnisme musclé au nom de l'idéologie libérale.
Pour Jeffrey Goldberg, Barack Obama incarne une nouvelle idéologie en rupture avec celle de l'establishment américain
De cette complicité découlent de grandes carences journalistiques. Dans son discours devant l'ONU en septembre 2015, le président Obama n'a pas évoqué une seule fois l'emploi d'armes chimiques par le régime syrien. Un vrai journaliste lui aurait demandé, pourquoi ? Se pourrait-il que ce soit parce que les fameuses armes, dont le soi-disant déploiement par l'armée syrienne en août 2013 était le prétexte de la guerre, n'ont en réalité jamais existé ? Si en revanche elles ont été utilisées, comme Jeffrey Goldberg l'affirme sans ambages et sans tenir aucun compte du manque de preuve et des doutes légitimes, le président est coupable d'un grand acte de fumisterie d'auto-justification en en faisant abstraction. Mais le journaliste n'a aucun intérêt à démasquer une telle manoeuvre car il veut au contraire attribuer à Barack Obama une idéologie qu'il entend combattre.
On peut donc se réjouir de certains de propos du président Obama, et notamment de son affirmation éminemment conservatrice (dans le sens anglais et positif du terme) selon laquelle on ne pourra jamais résoudre tous les problèmes de la planète. Ce sont des propos dignes d'un Canning ou d'un Edmund Burke. Mais de tels propos sont largement compensés par un américano-centrisme agaçant où Obama serait à l'origine du projet de désarmement de la Syrie (alors qu'en réalité c'était une initiative russe), mais où ce sont les Britanniques et les Français qui seraient responsables du chaos en Libye (alors que, comme l'avoue le président, sans l'apport militaire américain, la campagne aérienne franco-britannique n'aurait jamais remporté la victoire, alors que les conseillers américains étaient tout aussi aveugles que leurs homologues européens face au danger d'un écroulement de l'Etat libyen).
La banalité de l'aveuglement d'Obama est d'autant plus désolante qu'elle est partagée par la totalité de la classe dirigeante occidentale
De même, ce sont les Russes qui auraient envahi la Crimée et non pas les Criméens qui ont voulu quitter l'Ukraine putschiste pour regagner le berceau national - et encore moins les Américains qui ont encouragé les hommes de violence à Kiev, déterminés à s'emparer du pouvoir par la force en assassinant si nécessaire le président Yanoukovitch et le premier ministre Azarov. C'est Vladimir Poutine qui veut augmenter son pouvoir en déployant la force militaire mais non pas les Américains depuis plusieurs décennies. C'est la Russie qui a essayé de retenir son «Etat-client», l'Ukraine, et non pas l'Europe et l'OTAN qui sont déterminés depuis 1991 à repousser toujours plus loin à l'Est leur sphère d'influence. Selon Barack Obama, la Russie aurait même envahi la Géorgie en 2008 !
Pour Jeffrey Goldberg, Obama incarne une nouvelle idéologie en rupture avec celle de l'establishment américain. Pour un observateur extérieur, il en continue toutes les erreurs d'analyse les plus préoccupantes. La banalité de l'aveuglement de Barack Obama est d'autant plus désolante qu'elle est partagée par la totalité de la classe dirigeante occidentale. En revanche, avec la perspective d'une élection présidentielle entre Hillary Clinton, une femme profondément sinistre qui a été auteur ou complice de plusieurs guerres américaines et qui est «la reine du chaos» pour reprendre l'expression de la journaliste Diana Johnstone, et Donald Trump qui veut torturer les personnes suspectées de terrorisme encore plus que ne le faisait George W. Bush, l'avenir n'est guère encourageant. Par rapport à ces monstres, Barack Obama paraîtra un homme raisonnable. Face à ce qui nous attend, nous finirons par le regretter.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.