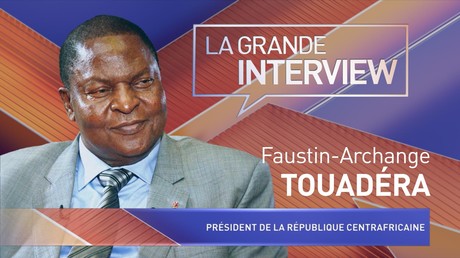Le discours politico-médiatique russe pointe souvent la responsabilité des Européens dans le conflit en Ukraine, tout en détournant le regard des États-Unis. Pour Karine Bechet, s’il s’agit principalement d’une stratégie communicative, elle n’en est pas moins sans conséquences politiques néfastes pour la Russie.
Le discours politico-médiatique russe peut parfois surprendre et surprend. Les Européens y sont qualifiés de « parti de la guerre », quand les États-Unis de Trump seraient des faiseurs de paix, alors que c’est bien ce pays (dont il est le président) qui est à l’origine du conflit et l’entretien, puisqu’il ne peut se permettre de perdre.
Ainsi, selon le Renseignement extérieur russe, les « pays européens de l’OTAN » veulent continuer la guerre et préparent pour cela un acte de sabotage de grande envergure contre la centrale nucléaire de Zaporojié, pour enfin avoir des victimes sacrificielles en Europe et ainsi changer la perception, puis la configuration du conflit.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré récemment : « Le Royaume-Uni et l'UE tentent de convaincre les États-Unis d'abandonner leur intention de résoudre la crise ukrainienne par des moyens politiques et diplomatiques, et de s'engager pleinement dans des efforts visant à exercer une pression militaire sur la Russie — autrement dit, de rejoindre enfin le « parti de la guerre ».
Cette position focalisée sur l’Europe peut surprendre pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les États-Unis sont non seulement membres de l’OTAN, mais d’eux dépendent toutes les décisions importantes. Ce que la Russie sait parfaitement et le déclare par ailleurs, comme ainsi par la voix de l’Ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov : « Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, au sein de l'OTAN, il n'y a qu'une seule puissance qui prend les décisions pour tous : les États-Unis. Les alliés ne font que suivre. ».
Ensuite, bien que les États-Unis déclarent régulièrement revoir leur approvisionnement du front ukrainien en armes, le front reste approvisionné – en armes et en renseignement militaire, les missiles américains continuent à frapper la Russie. N’oublions pas que sous Trump, c’est le mécanisme de financement qui a été revu, pour non seulement ne plus peser sur le budget américain, mais devenir rentable pour le complexe militaro-industriel américain. L’OTAN et l’UE ont mis en place des schémas de facilités d’achat de l’armement américain pour le front ukrainien et Trump les stimule ouvertement à renforcer leurs commandes, allant jusqu’à la menace quand la diplomatie n’est pas suffisante. Peut-on dire pour autant, que les États-Unis sont sortis du jeu, comme Trump tente de le faire croire ? Ce serait soit naïf, soit de très mauvaise foi.
Enfin, si les pays européens sont des satellites, comment peuvent-ils à ce point peser sur la ligne stratégique américaine ? Depuis quand des satellites peuvent-ils avoir une autonomie décisionnelle dans des domaines stratégiques ? Les satellites ne décident que des questions locales, et encore, dans le cadre imposé par le Centre. Donc, soit les pays européens peuvent influencer la ligne globaliste américaine et ils ne sont pas des satellites, soit ils sont des satellites et ne peuvent pas influencer la ligne stratégique globaliste américaine.
La Russie n’est pas naïve et comprend parfaitement la contradiction interne du discours politico-médiatique ainsi produit. Selon certaines interprétations, et il y a de fortes chances que tel soit le cas, il serait le résultat d’une stratégie communicationnelle visant à protéger un canal de communication avec le Centre globaliste (les États-Unis), afin de pouvoir garder, même difficilement, quelques chances pour un règlement négocié du conflit en Ukraine.
La possibilité même d’une réelle négociation, c’est-à-dire d’une possibilité de prise en compte par les Globalistes des intérêts stratégiques de la Russie, laisse perplexe, au minimum parce qu’ils n’ont aucun intérêt à offrir la victoire à la Russie. Trump, d’ailleurs, l’a fait comprendre en refusant la rencontre avec Poutine à Budapest, qu’il avait lui-même proposée, quand il fut clair pour les Globalistes que la Russie refusait un simple cessez-le-feu général, devant laisser le temps à l’armée atlantico-ukrainienne de se refaire une santé. Donc, le seul intérêt pour eux est bien l’utilisation de la voie diplomatique pour obtenir ce qu’ils ne peuvent obtenir sur le front, à savoir stopper l’avancée de l’armée russe.
Dans ce cadre, même si le discours politico-médiatique russe est volontairement produit de cette manière, il soulève beaucoup de questions. Rappelons, qu’en période de conflit armé, ce discours doit remplir deux fonctions : dissuader l’ennemi et consolider la société. Autrement dit, un même discours a deux publics différents, ce qui oblige à des modulations précises.
On peut légitimement se demander si le discours ainsi diffusé est en mesure de remplir ces fonctions.
Sans s’abaisser au niveau de la logorrhée trumpienne, soutenir le président américain pour le Prix Nobel de la paix est un exemple des excès et dérives de la communication politique russe, qui empêche toute possibilité de dissuasion.
Mais d’une manière générale, ce discours s’inscrit dans le paradigme politico-communicationnel « parti de la paix » / « parti de la guerre », imposé par les Atlantistes. La classification est simple, simpliste et même volontairement primaire : la « paix » − c’est bien, la « guerre » − c’est mal. Quelle que soit la paix, elle est censée incarner le bien absolu. Or, qui peut-être contre le Bien ? Les « méchants ».
Trump parle de paix, les dirigeants européens parlent de paix, même Zelensky parle de paix. Ils sont donc censés être dans le camp du « bien ».
Pourtant, de quelle « paix » parlent-ils ? Ils ne veulent qu’imposer un cessez-le-feu à la Russie, au nom de la « paix », car « des gens meurent », comme le répète sans cesse Trump. Ils veulent imposer la Pax Americana, qui reste le seul modèle de « paix » acceptable dans le Monde global.
Ainsi, quand la Russie ne veut pas d’un simple cessez-le-feu, puisque cela ne règlerait pas les sources du conflit, elle refuse, de leur point de vue, « la paix ». Pourtant, il ne peut y avoir de véritable paix sans régler les sources d’un conflit.
Parallèlement, les Américains ont développé le concept de « paix par la force ». La guerre est alors justifiée, quand elle permet d’aboutir à la « paix », c’est-à-dire à la Pax Americana, à la pacification du Monde global autour de ses intérêts supérieurs.
Donc, la guerre est aussi dans le « bien », mais uniquement quand elle sert leurs intérêts.
La Russie a repris ce paradigme, en tentant d’en renverser le contenu. Elle est pour la « paix », une paix qui tienne compte de son intérêt national. Mais elle n’a pas intégré la justification de la guerre pour arriver à sa « paix », qui reste alors dans le camp du « mal ». Et lorsque les « pacifistes » des pays amis défilent avec leurs plans de paix divers et variés, qui ne sont que des variantes légères de la Pax Americana n’ayant pour but que de pacifier le Monde global et de faire en sorte que, in fine, la Russie ne s’y oppose plus et rentre dans le rang, celle-ci est bien obligée de les remercier – puisqu’ils sont pour la « paix », et affirmer y réfléchir.
Cette stratégie politico-communicationnelle russe est-elle efficace, permet-elle de remplir les fonctions de dissuasion de l’ennemi et de consolidation de la société, notamment des élites nationales ? Non, c’est une évidence.
Comme nous le voyons ouvertement, cette finesse diplomatique russe est interprétée comme de la faiblesse en Occident, qui ne voit dans la répétition des appels russes à négocier et à la « paix » qu’un moyen de la tenir en laisse diplomatique, un moyen de reprendre activement la politique du Roll Back tant que Trump est président.
Quant à la question de la consolidation de la société et surtout des élites, si dans un premier temps les Globalistes russes faisaient profil bas, ils se sont tous regroupés sous le drapeau de la « paix », − n’importe quelle paix vaut mieux que la guerre, s’appuyant sur un faux patriotisme pour miner la société et influencer le pouvoir ; même si aucun résultat concret n’a été obtenu de toutes ces négociations, de tous ces « gestes de bonne volonté » faits par la Russie. Leur logique est la même que celle des Européistes : si cela ne marche pas, c’est parce qu’il faut aller plus loin.
Jusqu’où ? Cela reste bien la question existentielle, que le pouvoir russe doit se poser. Quand une stratégie ne produit pas les résultats attendus, ce n’est pas parce qu’elle n’est pas conduite avec suffisamment de force, c’est parce qu’elle est défectueuse. Il faut donc en changer.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.

![[image d'illustration générée par l'intelligence artificielle]](https://mf.b37mrtl.ru/french/images/2025.11/thumbnail/690f0efe87f3ec53413e6851.jpg)