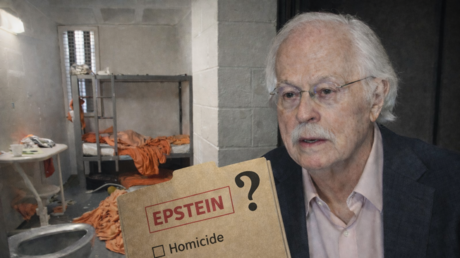Relégué au fin fond de l’actualité, le conflit meurtrier entre Arméniens et Azéris se poursuit. Une approche équilibrée s’impose, selon Pierre Lévy du mensuel Ruptures, qui relève une approche globalement partiale et manichéenne en France.
Depuis le 27 septembre, les combats font rage entre le Haut-Karabagh, soutenu par l’Arménie, et l’Azerbaïdjan, épaulé par la Turquie. En quelques semaines, les affrontements ont fait des milliers de victimes des deux côtés, militaires, mais aussi civiles. Un réel cessez-le-feu au plus tôt, tel devrait être l’espoir immédiat et prioritaire de tout homme de bonne volonté.
Pour cela cependant, il conviendrait d’éviter, de l’extérieur, toute approche unilatérale, partiale, manichéenne. Deux récentes tribunes parues dans Le Monde (28/10/2020) ne s’illustrent pas par un tel état d’esprit. L’historien Vincent Duclert d’une part, un collectif de quarante intellectuels d’autre part, signent ainsi des appels exhortant la France, et la communauté internationale, à prendre résolument parti pour la cause arménienne. C’est évidemment leur droit. Mais ils le font avec un tel parti pris qu’il n’est pas inutile de rappeler quelques faits.
A commencer par ceci, que chacun des deux textes passe scrupuleusement sous silence : c’est bien la partie azérie qui a le droit international de son côté. On peut certes arguer que ce n’était pas une raison pour déclencher les hostilités, on peut aussi honnir le président turc pour mille turpitudes, mais cela ne devrait pas empêcher de constater que le Haut-Karabagh, majoritairement peuplé d’Arméniens, n’a jamais été un Etat : territoire étendu et peuplé comme l’Ariège, il s’est autoproclamé indépendant en 1991, mais n’a jamais été reconnu par aucun pays – pas même l’Arménie. Pendant près de sept décennies, cette enclave était un oblast (district) autonome appartenant à la République soviétique d’Azerbaïdjan.
A la faveur de la dissolution de l’URSS, une longue guerre a opposé l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui s’est soldée par un cessez-le-feu en 1994. Celui-ci consacrait l’autorité de fait d’Erevan sur l’enclave disputée, mais aussi l’occupation par les forces arméniennes de plusieurs zones tampons autour de celle-ci. L’Azerbaïdjan perdait un septième de son territoire, et des centaines de milliers d’Azéris étaient chassés de leur terre à cette occasion.
Depuis lors, le dossier fait partie, dans le langage des diplomates, des «conflits gelés». Autrement dit, malgré l’existence d’un groupe de contact coprésidé par Moscou, Washington et Paris, aucune solution durable n’a été trouvée.
Vincent Duclert, dans son plaidoyer, rappelle l’histoire des liens tissés entre l’Arménie et la France depuis plus d’un siècle, l’engagement de nombreux intellectuels et politiques français aux côtés d’un pays qui a connu d’effroyables malheurs, et évoque les Arméniens qui ont lié leur destin à celui de notre pays. Tout cela est incontestable. Mais en quoi cela doit-il influer sur une analyse factuelle et équilibrée du présent conflit ? Il cite en conclusion les paroles d’un personnage d’un roman de Marcel Proust affirmant que «puisque les méchants sont armés (…), il est du devoir des justes de l’être aussi». Les «méchants» et les «justes», comme si cette approche morale et outrageusement simpliste était pertinente dans la géopolitique actuelle.
Le texte des quarante intellectuels donne encore moins dans la nuance. La guerre actuelle ne serait rien d’autre qu’un «projet d’extermination des Arméniens du Karabakh», s’inscrivant dans le projet «panturquiste» de l’«impérialisme fasciste turco-azerbaïdjanais», lui-même prolongement du génocide de 1915.
On n’est pas obligé d’avoir de la sympathie pour le président turc, ni d’approuver ses tropismes néo-ottomans proclamés, ni, évidemment, d’admirer les inquiétants coups portés aux libertés publiques dans son pays. En appuyant Bakou, Recep Tayyip Erdogan poursuit sans doute quelques objectifs peu avouables, y compris sur le plan intérieur. Mais de là à l’accuser de vouloir «exterminer» des populations entières, il y a un pas que la décence devrait dissuader de franchir, sauf à étayer ces très lourdes affirmations sur des déclarations avérées ou des éléments factuels. En cette matière si dramatique, les mots ne devraient pas être employés à la légère.
«Combien d’églises détruites faudra-t-il encore, après le bombardement de la cathédrale Ghazanchetsots de Chouchi ?», s’indignent les signataires. Hélas, l’honnêteté devrait imposer de mentionner que les attaques et les bombardements sur des populations civiles ont bien eu lieu des deux côtés. L’ethno-nationalisme, et ses terribles corollaires, ne sont pas réservés à un seul camp.
La balance entre «droit à l’autodétermination» et «intégrité territoriale» des Etats est un dilemme classique dans les relations internationales. Dès lors qu’un joug colonial historique est avéré, c’est évidemment le premier principe qui doit prévaloir.
Mais en Europe, le danger majeur est plutôt que la remise en cause des frontières n’ouvre une sanglante boîte de pandore. Les auteurs s’étaient-ils prononcés pour l’indépendance de l’Abkhazie rejetant le pouvoir géorgien ? De la Transnistrie russophone avide de se séparer de la Moldavie roumanophone ? Du Kosovo revendiquant, guérilla à l’appui, la sécession d’avec la Serbie ? Ce dernier cas est cependant particulier, puisque l’autoproclamation de l’indépendance put être obtenue «grâce» aux bombardements de l’OTAN de 1999, dans un contexte d’éclatement voulu et organisé de la Yougoslavie. Un éclatement qui n’apporta que du bonheur dans les Balkans, comme on sait…
Un point, enfin, mérite d’être noté : les deux textes semblent considérer que l’Arménie se retrouve abandonnée par ceux – les Français notamment – qui devraient la soutenir ardemment. Les analyses, commentaires et reportages de ces dernières semaines ne plaident pourtant pas dans ce sens. On chercherait en vain parmi les responsables politiques ou les grands médias des soutiens à la cause azérie – et ce, alors que cette dernière peut se prévaloir de quatre résolutions onusiennes successives.
Et si le nombre de reporters ou d’envoyés spéciaux dans le Caucase du Sud n’est pas considérable, force est de constater que l’immense majorité d’entre eux sont présents du côté arménien. Il faut beaucoup chercher pour avoir écho du point de vue azéri.
L’urgence est plus que jamais l’instauration d’un cessez-le-feu, malgré l’échec d’une quatrième tentative, le 30 octobre. Ensuite, une solution viable ne pourra passer que par des concessions de part et d’autre, qui préservent le droit de chaque pays – quoiqu’on pense des dirigeants azéris, turcs, ou arméniens d’ailleurs – à l’intégrité territoriale.
Parmi les dirigeants et grands médias occidentaux, il est de bon ton de dauber sur la phrase du président russe mille fois citée, selon laquelle l’éclatement de l’URSS aurait constitué une catastrophe géopolitique. Force est cependant de constater que les républiques qui constituaient l’Union soviétique ne se faisaient pas la guerre. Ce qui explique peut-être qu’en mars 1991, le référendum interrogeant les Soviétiques sur le maintien de l’URSS comme fédération donna 78% de votes favorables (80% de participation). Parmi les rares républiques dont les dirigeants refusèrent de prendre part à la consultation figuraient bien sûr les trois pays baltes. Mais aussi l’Arménie. On connaît la suite.
Pierre Lévy
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.