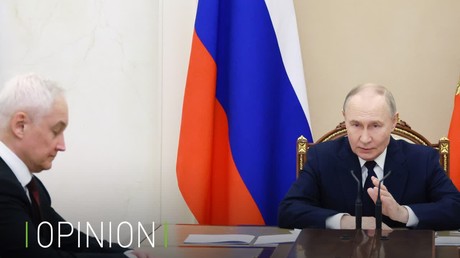A l’occasion des 60 ans de la Ve République l'écrivain Denis Tillinac analyse pour RT France l'héritage laissé par Charles De Gaulle et les paradoxes de la vie politique française sous Emmanuel Macron.
En toute logique c’est plutôt au printemps que le président Macron aurait dû se rendre à Colombey pour commémorer le 60e anniversaire de l'accession de De Gaulle au pouvoir. Au printemps de l’année 1958, tous les partis ayant orchestré la vie politique sous la IVe République étaient hostiles à ce retour aux affaires. Ils s'y sont résignés par crainte d’un coup d’Etat militaire.
Pour De Gaulle le mal qui avait rendu l’Etat impuissant et la gouvernance chaotique était le régime des partis. Il avait clairement annoncé son intention d’y mettre fin en dotant la France d’institutions nouvelles, et il s’y employa en toute priorité avec Michel Debré qui allait devenir son premier ministre.
Lorsqu’il avait quitté le pouvoir en 1946, il avait, lors du célèbre discours de Bayeux, proclamé la nécessité d’assurer la primauté de l’exécutif. Aussi fut-il décidé que le président de la République serait désormais la pierre d’angle de la vie publique, son animateur et sa vigie et non plus seulement son arbitre. En effet, l’ancien chef de guerre qu’était De Gaulle ne pouvait concevoir une responsabilité partagée. Il revint donc aux commandes non sans une certaine brutalité qui effraya à juste titre les partisans d’un régime d’assemblée, autant dit la quasi-totalité du personnel politique. Puis le locataire de l’Elysée, René Coty s’effaça et De Gaulle se fit élire président par un collège de grands notables.
En 1962, après avoir échappé de peu à un attentat au Petit-Clamart, il fit adopter par référendum l’élection du président de la République au suffrage universel. Deux tours de scrutin, pour éviter le risque d’une accession à l’Elysée d’un communiste. Dans un pays où l’inconscient collectif est marqué par quinze siècles de monarchie et hanté par le souvenir de la grandeur napoléonienne s’était institué une sorte de roi républicain. Les institutions lui confèrent des prérogatives qui le mettent très au-dessus des jeux partisans : chef des armées, droit de dissolution, nomination d’un premier ministre ne dépendant que de lui et révocable à sa merci. Ceci dans un cadre qui resta une démocratie parlementaire tout en se rapprochant d’un régime présidentiel.
Cette ambiguïté, souvent critiquée, présente l’avantage d’une souplesse dans l’interprétation des articles de la Constitution. Elle aura, de De Gaulle à Macron en passant par Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac Sarkozy, et Hollande, permis de surmonter plusieurs crises et de réguler les évolutions. La Constitution a survécu à trois cohabitations : 1986-88, 1993-95, 1997-2002. A vrai dire, la cohabitation – un président nommant un premier ministre issu d’une majorité opposée à la sienne – ne correspond en rien à la conception gaullienne. Rappelons pour mémoire que lorsque De Gaulle perdit le référendum de 1969, il renonça immédiatement à ses fonctions. Il avait d’ailleurs agi pareillement en janvier 1946, estimant que les institutions imposées par les partis (en gros les socialistes et les démocrates chrétiens) ne permettaient pas de gouverner le pays.
Certains de ses partisans ont pu souhaiter alors qu’il usât de sa légitimité de chef victorieux de la France libre pour instaurer une forme de dictature césariste. Il s’y refusa parce qu’il était à sa façon un vrai démocrate et un vrai républicain.
Quoiqu’on pense de la cohabitation, les institutions de la Ve République l’ont rendu possible avant de la banaliser. Elles auront survécu à la crise algérienne, à celle de mai 68 et surtout à une inflexion majeure : l’institution du quinquennat sous la présidence de Chirac. Elles n’ont pu cependant empêcher la réapparition progressive du «système des partis».
C’est un des paradoxes de la vie politique française : les partis sont nombreux, ils ont peu d’adhérents mais ils veulent peser lourd. Leur financement public par le contribuable leur assurent une certaine pérennité. La seule limite à leur emprise, c’est le mode de scrutin législatif uninominal majoritaire à deux tours. Jusqu’alors il a toujours assuré au président nouvellement élu une majorité à l’Assemblée nationale, fût-ce au prix d’une dissolution (1981, 1988). La concordance de temps des scrutins présidentiels et législatifs limite sans le supprimer le risque que le président soit immédiatement empêché de gouverner. En 2017, ayant été adoubé par les électeurs dans un contexte de rejet des partis de gouvernement (PS et LR) Emmanuel Macron a pu faire élire sous une casaque improvisée (En Marche) des députés dépourvus du moindre ancrage politique et de la moindre expérience. Il le paie aujourd’hui en terme de légitimité, même s'il est à peu près assuré de finir son quinquennat sans trop de tracas.
Plus généralement, la classe politique paie en monnaie de discrédit une évolution qui a réduit la vie politique à une série d’écuries partisanes constituées autour d’une personnalité présidentiable ou considérée comme telle. Ce dévoiement explique les divisions qui ont déchiré tant la droite LR que la gauche socialiste. La décision d’organiser des primaires pour départager les concurrents a provoqué mécaniquement l’essor des ultras de chaque bord, le FN de Marie Le Pen à droite de la droite et les insoumis de Mélenchon à gauche de la gauche. Aux dernières élections présidentielles quatre candidats (Macron, Fillon, Mélenchon, Le Pen) ont obtenu des scores très voisins ; aucun des quatre ne pouvait se prévaloir d’une légitimité liée à un courant de pensée réellement prégnant dans le pays. Aucun ne pouvait correspondre à l’idée que de Gaulle se faisait d’un homme d’Etat ayant rencontré l’adhésion profonde des Français. Ce scrutin présidentiel s’est apparenté à une série de coups de dés scandé par des péripéties imprévisibles : renoncement de Hollande, défaite de Juppé à la primaire de la droite, affaire Fillon, ralliement de Bayrou à Macron, débâcle de Marine Le Pen lors du débat présidentiel d’entre les deux tours.
Jusqu’à présent les responsables politiques préconisant une VIe République ont été et sont encore marginaux : Montebourg, Mélenchon. Mais les ajustements institutionnels ont tout de même affaibli le pouvoir du politique, exécutif autant que législatif. En sorte que l’opinion se lasse d’un fait présidentiel de plus en plus assimilé au fait du prince, voire à son caprice. La désacralisation de la fonction dans une société post-moderne où les référents sont tous frappés de déshérence s’est accélérée sous les quinquennats de Sarkozy et de Hollande. La pression du système médiatique y a largement contribué. Reste que la Constitution de la Ve République ayant survécu à trois cohabitations, huit alternances, et cinq dissolutions continue de protéger l’exécutif, mais sans pour autant redonner à l’Etat l’élan souhaitable pour assurer ses missions régaliennes dans ce vieux pays où il a précédé la nation. A la limite, ces institutions protègent trop le président. Elles ne laissent d’autres recours que la violence à la contestation de son autorité. C’est pourquoi le pouvoir de Macron, apparemment hors d’atteinte court des risques qu’il aura du mal à éviter parce que personne n’est en mesure de les prévoir. Méfiance donc car après avoir durant les premiers mois manifestement resacralisé la fonction, Macron semble voué au destin tronqué de ses prédécesseurs. Ou pire.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.