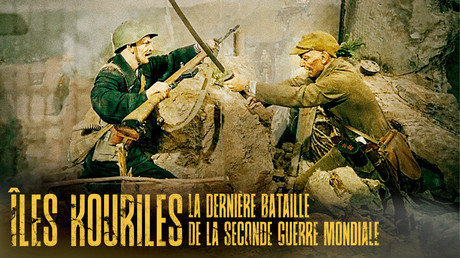Sénégal : un Livre blanc remis au président Faye pour «réhabiliter la vérité historique» sur le massacre de Thiaroye
 © X / WADR Francais
© X / WADR FrancaisLe président Bassirou Diomaye Faye a salué la remise d’un Livre blanc consacré au massacre de Thiaroye en 1944, lors d’une cérémonie solennelle, qualifiant ce travail d’«étape décisive dans la réhabilitation de la vérité historique» sur l’un des épisodes les plus sombres de la mémoire coloniale française au Sénégal.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu, le 16 octobre, lors d’une cérémonie au palais présidentiel à Dakar qui a réuni le Premier ministre Ousmane Sonko et plusieurs membres du gouvernement, un Livre blanc de 301 pages sur le massacre de Thiaroye, intitulé : « Le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1ᵉʳ décembre 1944. Un massacre de la Libération ».
L’ouvrage, rédigé par un comité de chercheurs dirigé par l’historien Mamadou Diouf, retrace un dossier mémoriel douloureux entre la France et le Sénégal, avec pour but de « réhabiliter la vérité » de l’histoire étouffée de ce massacre « prémédité » et « camouflé ».
« La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui ne célèbre pas un souvenir, elle consacre un acte de vérité », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, soulignant l’étape symbolique que représente la remise de ce document.
« Les autorités françaises ont tout fait pour camoufler » le massacre
Le massacre du camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, remonte au 1ᵉʳ décembre 1944, lorsque les troupes coloniales françaises ont tiré sur des tirailleurs africains pour avoir réclamé le paiement de leurs soldes, dont certains étaient d’anciens prisonniers de guerre rapatriés d’Europe, théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, le bilan faisait état de 70 morts, mais les auteurs du Livre blanc, se basant sur des fouilles archéologiques et des recherches historiques, estiment que ce chiffre serait compris entre 300 et 400 soldats africains massacrés.
Les victimes n’étaient pas uniquement sénégalaises : des tirailleurs de Côte d’Ivoire, du Mali, de Haute-Volta (aujourd’hui le Burkina Faso) et de Guinée comptaient aussi parmi les morts.
« Les autorités françaises ont tout fait pour camoufler [la tuerie] ; elles ont modifié les registres de départ [des tirailleurs de France] et d’arrivée à Dakar », affirment les rédacteurs.
Mutilations glaçantes
Les fouilles archéologiques menées à Thiaroye ont permis d’exhumer « sept squelettes » enterrés dans « des tombes postérieures aux inhumations ». Des mutilations glaçantes ont également été constatées : l’un des squelettes était, en effet, « caractérisé par une absence de crâne et une partie gauche dépourvue de côtes ». Sur un autre, « des restes de chaînes de fer aux tibias gauche et droit » ont été découverts.
Si plusieurs objets personnels des tirailleurs africains ont été retrouvés, les chercheurs recommandent toutefois de poursuivre les analyses anthropologiques et génétiques afin d’identifier les victimes et de localiser d’éventuelles fosses communes.
Cette demande a été validée par le président sénégalais, qui a autorisé la « poursuite des fouilles archéologiques sur tous les sites susceptibles d’abriter des fosses communes ». Il a également souligné que « la vérité historique ne se décrète pas, elle se découvre, excavation après excavation, jusqu’à la dernière pierre soulevée ».
Pour la mémoire collective de l’Afrique
Le Livre blanc invite à associer les pays africains — notamment la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali — aux futures commémorations, afin de rendre justice à ces combattants africains victimes d’une répression occultée par la France, malgré leurs efforts et leurs sacrifices pour libérer ce pays du joug nazi.
Le président français Emmanuel Macron avait reconnu en 2024 le « massacre » perpétré par les forces coloniales françaises à Thiaroye. Cet aveu, toutefois, « ne va pas au-delà des mots », selon Bassirou Diomaye Faye, qui a regretté la réticence française à ouvrir pleinement ses archives, estimant que « la coopération attendue de la République française n’a pas toujours été à la hauteur de nos espérances ».