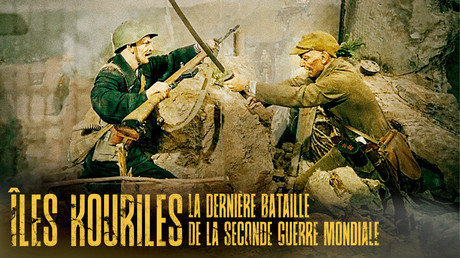RDC - Rwanda : nouvelle tentative de relance du processus de paix à Washington

Quatre mois après la signature d'un accord de paix bilatéral, les délégations rwandaise et congolaise se retrouvent à Washington pour tenter de relancer un processus au point mort. L’absence de reddition des combattants hutus des Forces démocratiques de libération du Rwanda interroge l’efficacité du plan et fragilise la coopération militaire.
Les 21 et 22 octobre, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda se retrouvent à Washington pour une nouvelle session du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité régionale. Ce processus avait été lancé après la signature, le 27 juin 2025, d’un accord de paix sous médiation américaine. Mais cette réunion se tient dans un climat de fortes tensions entre les deux pays.
Kinshasa accuse directement Kigali de soutenir le groupe armé M23, actif dans l’Est congolais, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Kigali, de son côté, justifie sa posture sécuritaire par la présence dans la région des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe rebelle hutu accusé par Kigali d’être issu d’anciens responsables du génocide de 1994.
C’est dans ce contexte explosif que le mécanisme de coordination tente d’organiser une réponse commune aux groupes armés. L’objectif annoncé est de désamorcer les tensions militaires par des actions concertées, tout en garantissant un minimum de communication entre les deux armées. Mais sur le terrain, les faits contredisent le discours officiel : les opérations transfrontalières se poursuivent, les affrontements n’ont pas cessé, et la confiance entre les deux gouvernements est pratiquement inexistante.
Une première phase sans résultats concrets
Lors de leur précédente réunion, les 17 et 18 septembre, les deux délégations avaient adopté un document stratégique qui définissait les premières étapes de leur coopération. Une première phase, enclenchée le 1er octobre, prévoyait des actions non offensives : sensibilisation, coordination, échanges de renseignements. L’objectif était d’amener les membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda à se rendre, soit aux forces armées congolaises, soit à la MONUSCO.
Trois semaines plus tard, le constat est un échec. Aucun combattant ne s’est rendu, ni à l’armée congolaise, ni à la mission onusienne. Cette absence de résultats remet en question la viabilité de la démarche engagée. Le processus est ainsi bloqué, avant même le début des opérations censées être plus complexes.
Parallèlement, le texte signé en juin prévoit également la levée des « mesures défensives » du Rwanda, un terme qui désigne notamment le soutien à l’organisation politico-militaire du M23. Celui-ci continue de contrôler des zones stratégiques. Or, le retrait des troupes rwandaises, prévu dans l’accord, n’a pas été appliqué. Les affrontements se poursuivent sur le terrain, malgré l’existence d’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu.
Un processus fragilisé par les tensions persistantes
À Washington, les discussions doivent désormais décider si le processus peut évoluer vers une phase plus active : des opérations ciblées contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda, la fin des incursions ponctuelles et un désengagement progressif des troupes rwandaises du territoire congolais. Le rôle logistique et de surveillance de la communauté internationale sera également débattu, bien que cette présence extérieure n’ait pas permis jusqu’ici d’imposer le respect des engagements signés.
Entre-temps, le climat politique reste marqué par une escalade verbale. Kinshasa et Kigali s’accusent mutuellement de soutenir des groupes armés, rendant toute avancée diplomatique précaire. Les populations civiles continuent de subir les conséquences directes des exactions et déplacements, dans une région où les forces de maintien de la paix peinent à contenir les violences.
Malgré la médiation américaine, la troisième session du mécanisme bilatéral apparaît davantage comme un exercice de maintien du dialogue que comme un réel tournant politique. L’absence de progrès sur le terrain souligne l’ampleur des blocages à surmonter pour les deux pays.